A la fin des années 50, débarquent au Brésil un réalisateur français et son actrice principale, afro-américaine, pour tourner une version revisitée du mythe d'Orphée et d'Eurydice avec les favelas de Rio en son centre. Entre racisme systémique et évolutions de la société brésilienne, Estelle-Sarah Bulle peint un portrait sans concession du Brésil - mais aussi de la France et des Etats-Unis - tout en éclairant l'histoire d'un film culte.
Aurèle Marquant, réalisateur français vieillissant, décide de tourner son film - celui qui doit lui apporter finalement la gloire alors que les réalisateurs de la Nouvelle Vague font de plus en plus parler d'eux - au Brésil, mettant en scène sa femme, Gipsy Dusk, une jeune actrice afro-américaine venue en Europe chercher le succès et ne demandant qu'à faire ses preuves. A ses côtés, il ne veut que des acteurs Noirs, des amateurs qui pourront amener naïveté et spontanéité aux personnages dramatiques du mythe d'Orphée et Eurydice qu'il souhaite revisiter. Travaillant avec des poètes et des musiciens brésiliens, Aurèle espère donner naissance à un Orfeu Negro lumineux, en Technicolor, aux couleurs chatoyantes et à la musique entêtante qui sera peut-être - qui sait ? - sélectionné pour le festival de Cannes 1959.
Rio, entre villas et favelas
En cette année 1958, le Brésil et son gouvernement n'ont qu'une obsession : entrer dans la "modernité". Le pays est en transition, et espère se développer économiquement et culturellement le plus rapidement possible. C'est un Brésil multiculturel et multiethnique que l'autrice nous présente, à l'image de la multitude et de la diversité de ses personnages qui se croisent, se toisent et se mélangent. "Le Brésil, du Président au cireur de chaussures, se proclamait métis. Un seul peuple, mélangé depuis les origines, sur la voie de la prospérité et sous la même devise, Ordre et Progrès. Un refrain romantique seriné par la presse et le gouvernement. Norma était pourtant bien placée pour savoir que les descendants d'esclaves seraient toujours au service de l'élite aux origines allemandes, italiennes ou portugaises."
Mais c'est surtout un Brésil divisé qui se dessine sous nos yeux : un pays où des milliers habitent dans des favelas insalubres alors que quelques uns se partagent les villas des collines et un style de vie occidentalisé. Estelle-Sarah Bulle illustre à merveille les rapports de classe qui se jouent dans la société, ainsi que leur représentation : quelle image le Brésil veut-il renvoyer au reste du monde ? Comment un Français étranger à cette société complexe peut-il en montrer les différents aspects sans trahir ? "Norma écoutait en réprimant parfois un sourire, car la vision de la favela que souhaitait déployer Aurèle lui semblait tout à fait simpliste. Un peu comme ces feuilletons à épisodes du Manchete, qu'aimaient lire les clients du salon de coiffure le temps de la coupe, avant de reposer négligemment le journal sur le comptoir. Des histoires où les blondes étaient des femmes fatales, les brunes des épouses sages, et les Noires, des prostituées ou des domestiques vénales qui, par contraste, rehaussaient toutes les Blanches et en faisaient la valeur."
Accompagné de ses amis poètes et musiciens brésiliens - entre autres Viniciùs de Moraes, auteur d'une pièce de théâtre qui inspire Aurèle, et le désormais très célèbre chanteur de bossa nova, Joao Gilberto -, Aurèle veut montrer la poésie de ce qui sort des favelas et compte bien sur ses acteurs pour la retranscrire avec vérité et sans romanticiser. Malgré les bonnes intentions du réalisateur, l'autrice rappelle toujours que le cinéma n'est qu'une représentation de la réalité, sur laquelle est apposé un filtre qui transforme ce que l'on voit : entre préoccupations financières et récupérations politiques, Orfeu Negro n'est que la mise en scène d'une réalité filmée par les yeux d'un étranger, si belle soit-elle.
"Nous sommes comme des dieux dans cette histoire"
Estelle-Sarah Bulle n'oublie jamais de remettre le tournage de ce film dans son contexte historique : celui de la Guerre froide et d'une Amérique latine que les Etats-Unis considèrent toujours dans leur sphère d'influence, qu'il convient de protéger des assauts de communisme qui guette, comme à Cuba. La culture prend alors cet aspect de bataille d'influence dans laquelle la musique et le cinéma sont essentiels. Gipsy, l'héroïne du film d'Aurèle, se retrouve bien malgré elle au cœur de cette bataille de "soft power", pour un pays qui la rejette en raison de sa couleur de peau et ne fera certainement jamais d'elle une star de cinéma - une étoile filante - quel que soit son talent. "Protégés par le Gouvernement, imbus de leur importance, Dianne et ses pareils disaient se battre pour les valeurs de l'Amérique. Un pays qu'elle-même avait fui, car en y demeurant, elle serait devenue malade d'injustice. Elle se serait consumée dans la fournaise de la haine, aurait retourné contre elle-même la lame acérée du racisme triomphant et après quelques pas, se serait écroulée, écorchée vive. Son pays ne l'aimait pas, mais elle en faisait indéniablement partie. Alléluia !"
Les étoiles les plus filantes, ce sont les acteurs et actrices de ce film, jeunes gens plein d'espoir autant que désabusés par la vie dans ces favelas, par ce système politique dans lequel ils ne peuvent complètement s'intégrer. Breno, Norma, Eva, Baden, Gipsy et les autres sont riches de leurs relations, et l'autrice passe du temps à développer leurs sentiments, la complexité de ce qu'ils ressentent face à ce film, aux opportunités qu'il pourrait entraîner et à la réalité. Alors que l'histoire d'amour entre Orphée et Eurydice se déploie devant eux sur le plateau de tournage, les personnages sont pris dans leurs propres histoires d'amour : des relations amoureuses vécues comme des relations sociales où les rapports de domination, de pouvoir et d'intérêts sont présents. L'autrice expose notamment ce que cela signifie d'être une jeune femme noire au Brésil dans ces années-là, dans les fantasmes et dans les représentations.
"Contrairement à ce que pensait Milton, vivre une passion amoureuse ne nourrissait pas son travail d'actrice, au contraire. Seule, elle économisait l'immense énergie que les femmes réservaient d'ordinaire à satisfaire les exigences de leurs amants et ce qu'elles croyaient alors être leurs propres besoins. Seule, elle pouvait réfléchir et ressentir plus intensément. Il ne fallait pas trop accorder à l'amour quand on était véritablement engagé dans son art. Quand on était une véritable actrice."
Alors que l'atmosphère d'après-guerre et de développement fait rage, Estelle-Sarah Bulle met en scène cette jeunesse qui sait qu'elle passe d'une époque à une autre, tout en mettant en lumière les paradoxes de la France de Malraux, des Etats-Unis en guerre contre l'URSS et du Brésil en transition, insistant sur les formes de racisme qui minent ces trois sociétés en même temps que sur la richesse des productions culturelles. Les étoiles les plus filantes est un très beau roman, empli des couleurs du Carnaval et des sons de la bossa nova, à lire avec un album de Joao Gilberto dans les oreilles !
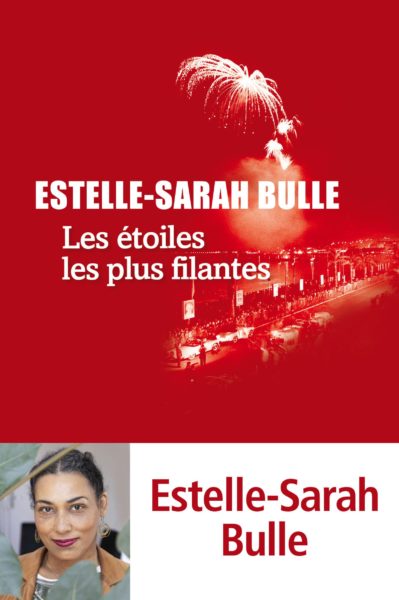
"Les étoiles les plus filantes", Estelle-Sarah Bulle, Editions Liana Levi, 432 pages, 21€
Découvrez d'autres livres de l'autrice :
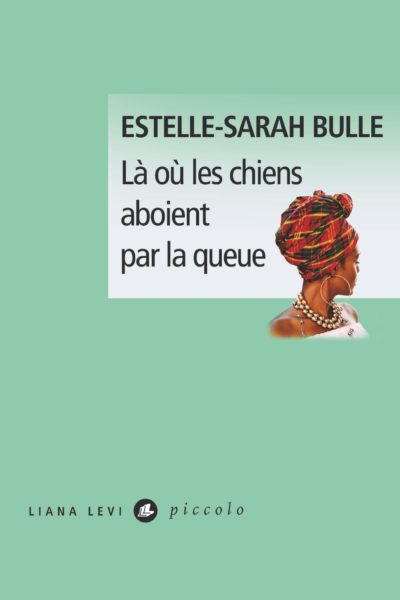 |

