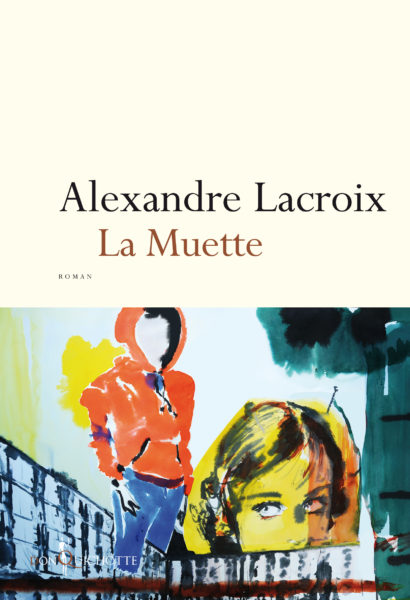Fondateur de l'école d'écriture Les Mots, romancier et essayiste, professeur de littérature et d'écriture créative, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine... Alexandre Lacroix a exploré de multiples domaines du langage avec la question du travail sur les mots au centre, un questionnement sur l'abstraction de la langue française. Nous l'avons rencontré pour l'interroger sur son dernier livre paru lors de la rentrée littéraire 2017 aux éditions Don Quichotte, La Muette.
Pouvez-vous résumer votre livre La Muette ?
J'avais publié un précédent roman qui s'appelle Voyage au centre de Paris, et qui était une exploration géographique de Paris : un narrateur se promène et va rejoindre une femme, il évoque les lieux de Paris parfois très en détails, en parlant de ses souvenirs. Quand j'ai publié ce livre, je m'étais fait un reproche, celui de n'avoir parlé que des quartiers centraux, chics, puisque mon personnage déambule entre les quartiers du Luxembourg et le 3e arrondissement parisien. Je voulais donc faire un pendant, parler de la banlieue et en commençant à prospecter, je suis tombé sur une histoire qui m'a sidéré : la cité de la Muette à Drancy.
On n'est pas habitués à penser la banlieue comme un lieu de mémoire, et la Muette est un lieu très particulier en cela que cette cité a été construite pour être un habitat populaire de grande qualité avec une ambition architecturale et artistique. Mais le chantier s'arrête net dans les années 30 à cause de la crise, et les bâtiments inachevés sont réquisitionnés pendant la guerre pour servir de camp d'internement et de transit. C'est un lieu par lequel sont passés presque tous les déportés français, il a été en fonctionnement pendant trois années. Le camp a été dirigé durant sa dernière année par Aloïs Brunner, qui a mis en place une administration juive du camp : associer les victimes à leur propre malheur et leur propre dégradation, ce qui crée un système de pression par la terreur.
Ce qui m'a sidéré, c'était d'apprendre que l'histoire du camp ne s'était pas arrêtée là et qu'en 1947 avait été prise la décision de le transformer en logement populaire et de loger des ouvriers principalement, en finissant à la va-vite les immeubles. Des gens logent encore aujourd'hui dans ce lieu de mémoire, qui a été le principal camp français.
J'ai fait cinq ans d'enquête, en m'y rendant régulièrement par demi-journées, mais je ne savais pas ce qui allait en sortir, si ça serait un essai ou un roman. Au départ, je voulais comprendre le lieu, son passé, son présent. Petit à petit, c'est un dispositif romanesque qui a émergé et j'ai choisi d'alterner deux voix : celle d'un adolescent d'aujourd'hui, Nour, qui raconte sa vie dans la cité pendant qu'il est en garde-à-vue ; et celle d'Elsa, une survivante, qui raconte sa déportation à un historien. Ils sont tous les deux face à quelqu'un qui enregistre leur parole, ils sont face à une institution, l'histoire pour l'un et la police pour l'autre, et ils racontent leur histoire et leur vision du même lieu.
En plus d'Elsa et Nour, il y a un troisième personnage : la Muette et ses bâtiments. Quelle est l'influence du lieu en lui-même dans la construction de vos personnages ?
Comme pour le livre sur Paris, c'est vrai que le personnage central c'est le lieu. Evidemment, il ne s'exprime pas en tant que tel mais ce que j'essaye de faire, c'est saisir l'esprit de ce lieu... Et rien que son nom, la Muette, c'est incroyable : c'est ce qu'on ne veut pas voir dans l'histoire de France, ce passé collaborationniste, et dans la société française, ce problème de banlieue irrésolu et inquiétant. Ce qu'on ne veut pas voir, ni nommer, ni décrire, ni raconter est condensé dans un lieu qui s'appelle la Muette.
Le lieu est aussi intéressant parce que le présent recouvre le passé : le mémorial est de l'autre côté de la rue, il ne se visite plus. Une petite statue et un wagon témoin marquent l'entrée de la cité, mais une fois qu'on est dans la cité, c'est une banlieue ordinaire et il n'y a pas de repère sur les maisons, les portes,... C'est comme si on avait fait disparaître le passé alors que si on s'attarde et qu'on discute avec les gens, on s'aperçoit que le passé est totalement obsédant et que le lieu est hanté. C'est un lieu poursuivi par une malédiction qui continue d'être active. Ca me semblait intéressant de raconter ça à travers des histoires, des destins.
Il aurait certainement fallu faire un musée de ce lieu ou le détruire plutôt que d'y loger des gens précaires. Mais maintenant, on ne peut pas déloger ces centaines de familles, et les gens se coltinent ces spectres du passé, ils sont d'ailleurs oubliés et délaissés de tous.
Dans votre dernier chapitre du livre, vous utilisez le "je" et expliquez en quelque sorte comment vous est venue l'idée du roman. Ce que vous racontez sur vos moments à Drancy fait penser à une étude anthropologique. Comment êtes-vous passé de vos observations à la fiction ?
Pour ce qui est du passé, je voulais réussir à reconstituer la vie quotidienne. J'ai donc cherché à apprendre des choses qui n'ont pas d'intérêt pour les livres d'histoire : par exemple, établir si les vitres des chambres étaient peintes en bleu, ce qui signifie que les détenus coincés dans les chambrées sont dans une lumière bleuâtre qui crée une certaine ambiance pour le roman. Je n'ai pas mené un travail d'historien, mais plutôt un travail presque trop attaché à des détails insignifiants, mais qui dans le cadre d'une histoire romanesque sont absolument indispensables. C'était une immersion dans le quotidien.
Ensuite, pour ce qui est d'aujourd'hui, ce qui a retenu le plus mon attention c'est la langue, parce que j'ai voulu faire un roman complètement bilingue : Elsa, la vieille dame, s'exprime dans un français un peu châtié ; alors que Nour a un parler très oral, très banlieue, avec du verlan, des mots qui viennent de l'arabe, du gitan. A la fin, j'ai fait un page à page avec un jeune qui connaît bien cette langue pour qu'il me dise ce qui se dit encore ou non, parce que je voulais être sûr que ça sonne bien.
Vous dites avoir voulu écrire le livre "gratuitement", pour donner une voix à la Muette que vous qualifiez de "trappe à l'exclusion" pour la France. En quoi pensez-vous qu'un récit fictionnel a plus de force qu'un recueil de témoignages ?
Je ne voulais pas faire un documentaire, je voulais approcher quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience humaine de ce lieu. Les deux personnages s'expriment à la première personne du singulier, ce qui fait qu'on est en immersion avec eux et qu'on est sans recul. Par exemple, avec Elsa, on va vivre la déportation. Et puis avec Nour, on va se mettre à la place d'un gamin qui a fait une connerie. On est avec lui, on n'est pas en train de porter un jugement sur lui, on voit le monde à travers ses yeux. Le lecteur voyage dans le lieu, en laissant au vestiaire toute forme de préjugé, juste pour avoir une approche émotionnelle, sensible de ces enjeux avant qu'elle ne soit politique.
Ce lieu condense beaucoup des problèmes qu'a la France - xénophobie, antisémitisme,... - on manie des bâtons de dynamite quand on s'intéresse à ce lieu. Je ne voulais pas être dans le jugement médiatique extérieur, mais être en prise avec la réalité de Nour et savoir comment il se représente la Muette, son histoire.
Avez-vous des inspirations spécifiques pour ce livre ?
J'ai lu beaucoup de livres d'histoire. Il y a aussi un livre de Faulkner, Les palmiers sauvages, qui m'a inspiré pour sa construction : ce sont deux courts romans qui n'ont rien à voir et qu'il a décidé d'entrelacer, ce qui donne deux univers complètement différents d'un chapitre à l'autre. C'est donc la métaphore de deux palmiers qui ne se croiseront jamais. Ici, Elsa et Nour sont reliés par un lieu, mais le mécanisme est proche, celui de deux histoires qu'on suit en parallèle.
Que lisez-vous en ce moment ?
Je viens de lire Les journaux de voyages de Bashô, le maître du haiku japonais. Je viens aussi de finir Lac de Jean Echenoz, qui est plus contemporain. Je lis dans toutes les directions, ce n'est pas forcément représentatif (rires).